Procédure en propriété intellectuelle : Protocole entre le TJ de Paris et l'Ordre des avocats de Paris
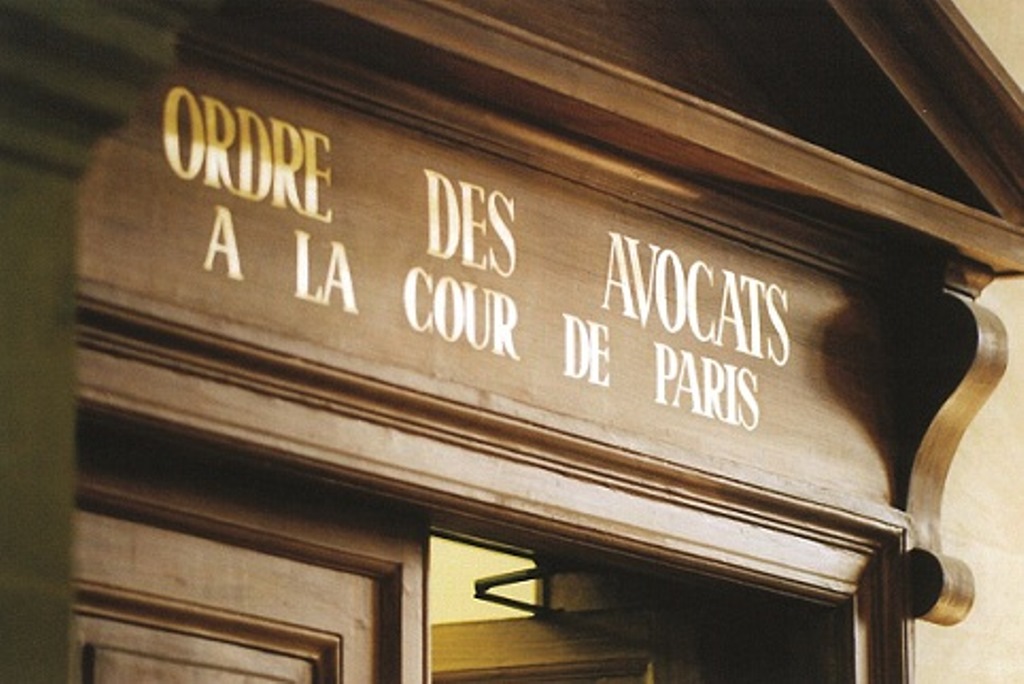
Le protocole signé le 20 décembre 2024 aborde 5 thèmes :
- les requêtes aux fins de saisie contrefaçon,
- la mise en état judiciaire ou conventionnelle
- les modes alternatifs de règlement des différends,
- les débats et le traitement de l'urgence
- l'accès en ligne à la jurisprudence rendue par la 3è chambre
Signature d'une Protocole avec le tribunal des activités économiques de Paris

Le présent protocole portant modernisation de la procédure afférente aux contentieux au fond (référés, requêtes et injonction de payer ne sont pas traités ici) a pour objectif d'améliorer l'efficacité du traitement des affaires dans le double souci du droit à un jugement dans un délai compatible avec les exigences de la vie économique des entreprises et du respect scrupuleux du code de procédure civile.
Montant pour 2025 de la rétrocession d'honoraires minimal

Le montant de la rétrocession minimal fixé par l'Ordre a changé à compter du 1er janvier 2025 puisqu'il est calculé sur la base du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.
Le PASS a augmenté de 1,6% au 1er janvier 2025 et passe à 3 925 €. Cette même augmentation s'applique donc au montant des rétrocessions d'honoraires.
Ces nouveaux montant s'appliquent à tous les contrats de collaboration en cours.
Les nouveaux montant sont les suivants :